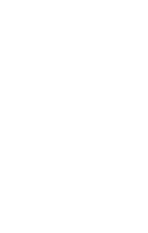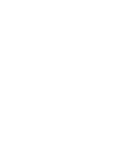Compétition du meilleur apprenti(e) pâtissier(ière)-Chocolatier(ière) 2024
Avez-vous ce qu’il faut pour rivaliser avec la relève du Québec ? Si la réponse est OUI, alors joignez-vous à la SCCPQ pour participer à

Compétition du meilleur apprenti(e) cuisinier(ère) 2024
Avez-vous ce qu’il faut pour rivaliser avec la relève du Québec 2024 ? Si la réponse est OUI, alors joignez-vous à la SCCPQ pour participer
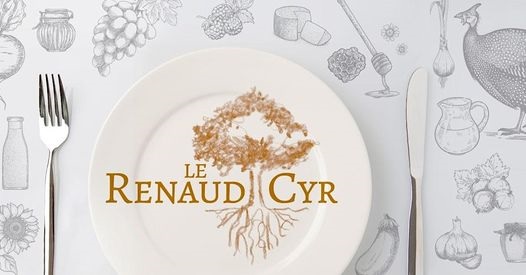
Reconnaissance Le Renaud-Cyr 2023.
Le 18 mars dernier avait lieu la célébration de la Reconnaissance Le Renaud-Cyr 2023. Une soirée hommage à Renaud Cyr – père de la gastronomie

«Votre métier, votre norme»
«Votre métier, votre norme» La norme professionnelle pour le métier de cuisinier(ière) détermine les critères essentiels et les références souhaitées au développement, à l’évaluation des

Gala de la présidence 9 octobre 2023
À vos agendas Lundi 9 octobre 2023 La Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec (SCCPQ) célèbre ses 70 ans d’existante, 70 ans d’histoire culinaire

Un pionnier de la cuisine québécoise tire sa révérence
Marcel Kretz 1931-2023 Un pionnier de la cuisine québécoise tire sa révérence❗️ Il fut un précurseur qui a inspiré toute une génération de cuisiniers, comme